Comment parler de la possibilité de systèmes juridiques « non étatiques » ?
Eléments de discussions et de réflexion autour de l’ouvrage Contributions à l’étude des systèmes juridiques autochtones et coutumiers, paru sous la direction de Guislain Otis, Presses de l’Université de Laval, 2018
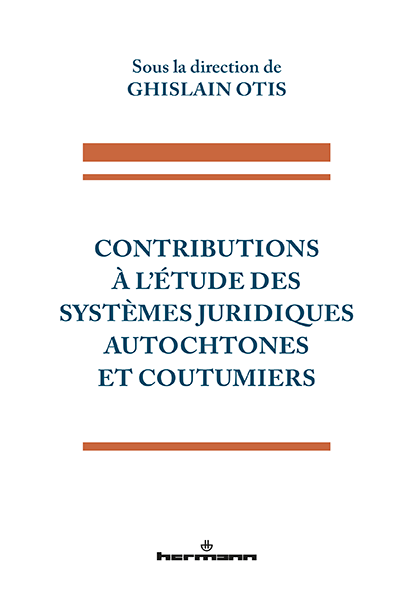
Les présentes réflexions ont été sollicitées par Pauline Gervier, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux, dans le cadre de la « conférence –débat » autour de la présentation de l’ouvrage le mercredi 7 novembre à Bordeaux (cette conférence précédait le colloque « Crise et pluralisme juridique » qui s’est tenu à Bordeaux les 8 et 9 novembre 2018). Leur caractère écrit altère peu ce que j’avais effectivement dit lors de la conférence. Je remercie beaucoup les rédacteurs de l’ouvrage ayant participé au débat (Guislain Otis, Sophie Thériault et Jean Leclair), pour leurs sincères interrogations et le plaisir de la discussion.
*
* *
Toute attention portée à la manière dont se structure et se repère le droit est précieuse pour l’analyse des sociétés. Beaucoup de choses dans ce livre ont suscité des interrogations ou des réactions de ma part et, comme il se doit, j’ai réalisé quelques choix pour en parler.
Devant l’exposé d’une recherche, quelle qu’elle soit, je suis d’emblée poussée à m’interroger sur les motivations profondes de l’auteur, motivations conscientes ou inconscientes, avouées ou inavouées : Que veut l’auteur ? Que veulent les auteurs, par la recherche qu’ils ont menée, et par la manière dont ils l’exposent ? Une lecture « critique » implique ce regard en creux, au-delà de ce que les auteurs affirment comme intentions explicites.
La précision est d’importance, parce que, il ne suffit pas d’affirmer quelque chose, une intention par exemple, pour que celle-ci soit celle effectivement poursuivie par ceux qui l’affirment. Il ne suffit pas non plus qu’une chose soit définie comme ceci ou comme cela, pour que la chose soit effectivement entendue dans ce même sens dans les réflexions des auteurs. Et encore, il ne suffit pas de se référer à la position, la démarche ou la méthodologie d’un auteur, ni de se réclamer de son drapeau, pour entraîner avec soi l’adoption effective d’une démarche ou d’une méthodologie. Bref, le dire ne fait que précéder le faire, qui peut être tout autre. Il ne fait pas nécessairement corps avec lui. Autrement dit, au-delà de l’affirmation explicite de certaines attentions et ou intentions, qui compte bien sûr (le fait d’affirmer quelque chose compte toujours), il s’agit de comprendre l’exposé d’une recherche ou d’une analyse, dans un article ou un ouvrage, par la découverte, au fil des développements, de ce qui se trame vraiment.
Cette démarche nécessite de commencer par poser « l’histoire » telle qu’elle est racontée dans l’ouvrage, d’interroger ensuite les modalités d’exposé de cette histoire, pour ensuite faire apparaître, au-delà d’une éventuelle morale explicite qui ponctue tout récit, les conséquences de l’histoire dans le paysage juridique et politique.
1. Quelle est la trame de « l’histoire » racontée dans Contributions à l’étude des systèmes juridiques autochtones et coutumiers ?
Il y a bien une histoire – ce n’est pas toujours le cas – en ce sens qu’il y a un propos, une thèse posée, qui implique autant qu’elle justifie l’ouvrage. En faisant défiler le propos depuis la p. 2 de l’ouvrage, on est vite « au parfum », si j’ose dire. Si j’ai bien compris :
– premièrement, « l’insécurité et la défaillance du droit » sont possiblement causées par l’absence de normes consensuelles, ce qui est l’équivalent pour les auteurs d’une lacune démocratique.
– Deuxièmement, l’absence de normes consensuelles est révélée par l’existence, la persistance de systèmes juridiques locaux, autochtones, que l’on dit être « à l’intérieur d’un système étatique », proposition que rejettent plutôt les auteurs, préférant l’idée de systèmes « coexistant » au système étatique. L’expression est en effet plus conforme à la thèse du pluralisme juridique, que ces systèmes « coexistant » soient effectifs ou simplement revendiqués par un groupe humain (je reviendrai sur cette idée de système revendiqué qui me semble un point clé de la trame de l’ouvrage).
– Troisièmement, une gouvernance plus « consensuelle », donc démocratique selon les auteurs, passe par une prise en charge constructive de la pluralité juridique.
– Quatrièmement, les chercheurs par leur travail de mise à jour et d’explicitation de différents systèmes juridiques coexistant, donnent des outils pour une prise en charge constructive de cette pluralité juridique. Il s’agit, disent-ils, d’établir les interactions entre les univers juridiques et d’établir des modèles aptes à favoriser le dialogue.
L’ouvrage s’inscrit donc dans une démarche politique assumée (quoique non affirmée comme telle) : il s’agit de permettre de faire des ponts entre le droit étatique et les droits non étatiques, notamment par la mise en lumière des valeurs à l’œuvre dans les droits non étatiques, intimant en quelque sorte au droit étatique d’en tenir compte.
A partir du traitement de la famille, du territoire et des modes de règlement des conflits, l’analyse des différents droits autochtones est ainsi égrenée par les différents auteurs par une mise en lumière des différentes valeurs des droits autochtones. Ce sont autour de ce svaleurs que pourraient s’élaborer des normes consensuelles et faire dialogue avec l’Etat. Par exemple, il est indiqué que ce projet vise à renforcer la gouvernance atikamekw en appuyant le développement d’un modèle de justice qui valoriserait et revitaliserait la culture juridique atikamekw en tant qu’elle peut utilement permettre la prévention et le règlement des conflits liés à la violence conjugale et familiale et à la protection de la jeunesse.
Chaque chapitre est ainsi ponctué de mises en lumière fréquentes des valeurs qui fonderaient les ensembles étudiés, une sorte de première mise à disposition d’analyses à partir desquelles réfléchir le dialogue estimé nécessaire.
2. Comment « l’histoire » est-elle racontée dans Contributions à l’étude des systèmes juridiques autochtones et coutumiers ?
Pour faire le chemin proposé par les auteurs, ceux-ci donnent évidemment des critères de reconnaissance de leur objet de recherche, qui permettront d’identifier les droits autochtones.
Dans cette perspective, il est d’abord dit que l’existence d’un ordre juridique ne dépend pas de sa reconnaissance par l’Etat. Et, pour sortir de l’aporie fameuse de la réductibilité ou de l’irréductibilité du droit à l’Etat, ils proposent non pas de définir le droit, l’ordre juridique ou le système juridique, mais la « juridicité ». On pourrait donc avoir de la juridicité sans droit, ce que j’avoue ne pas comprendre tout à fait puisque ce qui est juridique a structurellement trait au droit. S’il s’agit simplement de dire qu’il y a du droit non étatique, la distinction droit/juridicité n’a pour effet que de reproduire l’association entre droit et Etat, en contraignant les auteurs à trouver maladroitement un troisième terme, celui de juridicité, qu’ils empruntent d’ailleurs. Quoiqu’il en soit, la juridicité disent les auteurs, peut se « manifester par un ensemble de valeurs, de principes, de règles d’acteurs et de processus (ce que les auteurs appellent les variables élémentaires) concourant à la régulation d’un groupe et au règlement des conflits dans ce groupe ». Il y a un enchevêtrement, selon différentes combinaisons en fonction des cas, des valeurs, principes et règles tel qu’il y a,en quelque sorte, droit. Par ailleurs, il est acté que la reconnaissance de ces droits, peu souvent constitués de normes formelles, est permise par un regard sur les pratiques « réellement observées dans la vie quotidienne des personnes ». Si, de ce point de vue, on pourrait suivre les auteurs, la difficulté est que cette grille de reconnaissance n’est à proprement parler pas réellement suivie dans le reste des développements.
Il apparaît en effet que, en dépit de ce qu’une combinaison des différents éléments qui concourent à la régulation d’un groupe et au règlement des conflits définirait la juridicité, et de ce qu’il s’agit le plus souvent de tenir compte des pratiques réellement observées, le seul « souvenir » d’un système de juridicité semble suffire aux auteurs pour en faire un objet de connaissance éligible. Comme conséquence, c’est bien à partir du « souvenir » d’un système de juridicité que la légitimité de celui-ci pour entrer en dialogue avec le droit étatique est établie. Autrement dit, et en suivant la logique implicite des auteurs, un système de juridicité peut n’avoir aucune effectivité présente, ne peut plus exister vraiment, mais être reconnu comme un droit autochtone avec lequel l’Etat devrait dialoguer.
Plus, il est affirmé à plusieurs reprise que le droit autochtone comme support de la construction d’un dialogue conduisant à l’établissement de valeurs consensuelles dans un cadre démocratique, peut être certes effectif, mais plus simplement « revendiqué ». Le « souvenir » d’un système révolu ou l’existence d’un système juridique envisagé à l’état de système « revendiqué », et donc non « positif », suffirait ainsi à établir des droits autochtones obligeant un Etat à entamer un dialogue.
On a ainsi bien des difficultés à cerner les limites, et de la recherche et de sa portée politique : qu’est-ce qui fait la différence entre un système reconnaissable et crédible comme droit autochtone et un système qui ne le serait pas ? Si le souvenir et la revendication sont des soutiens pertinents de la reconnaissance d’un système, quels en sont alors les critères ? Qui ou quoi le souvenir concerne-t-il ? Avec quelle portée ? La notion de revendication quant à elle n’ouvre-t-elle pas la voie à un dialogue illimité et insoluble entre des valeurs distinctes et presque structurellement difficilement conciliables ? « Grâce à » ou « à cause de » la liberté d’expression, presque tout aujourd’hui est revendiqué, souvent selon des logiques historiques, claniques ou morales. Le propos des auteurs conduit donc à se demander s’il ne s’agirait pas d’accorder crédit et valeur à tout système combinant des valeurs des principes et des règles et se réclamant ou étant dans une condition de coexistence avec l’Etat, ce qui fait évidemment place dans cette catégorie à la plupart des systèmes mafieux ou aux nostalgiques d’un droit fondé sur des valeurs remises en cause aujourd’hui par les systèmes étatiques occidentaux, à l’instar de la question du patriarcat et du genre.
Les développements des auteurs semblent plutôt ignorer ces questions et les considérations épistémologiques et « théoriques » introductives laissent place à des choix entièrement inexpliqués :
– un choix d’abord a été fait de droits autochtones connaissables et susceptibles d’entrer dans une discussion avec l’Etat, qui ne se justifie que par leur seule entrée dans la définition des auteurs, et qui n’expliquent pas les exclusions qui ont été nécessairement faites.
– Les systèmes choisis ensuite, effectifs, peu effectifs voire pas du tout effectifs, pour la période présente ou passée, semblent, tout au long des développements, survalorisés quant aux valeurs et principes qu’ils portent, toujours présentés de telle sorte que le lecteur puisse en conclure qu’ils sont effectivement aptes au dialogue avec l’Etat dans le but d’établir des valeurs consensuelles. C’est ainsi que solidarité, éthique communautariste, service rendu, éthique du partage, de réconciliation et de réparation, sont autant de valeurs des droits autochtones systématiquement mises en avant par les auteurs, dans le cadre d’une analyse que l’on finit par trouver partiale, jusqu’à la caricature.
Une forme inévitable d’idéalisation des droits autochtones est ainsi construite, qui pourrait d’ailleurs expliquer les choix opérés. Par exemple, tel qu’il ressort des rapports, chez les Innus, les Secwépemc et les Bété, le territoire n’est pas assimilé à « un simple réservoir de ressources » par essence destiné à la seule satisfaction des besoins et des désirs immédiats des êtres humains. Prenant l’exemple des Innus, les auteurs décrivent le système qui régit la circulation entre les territoires de chasse comme étant « construit à partir d’un dosage équilibré de fermeté et de souplesse ».
S’il fallait expliquer sérieusement les choix qui ont été faits, cela impliquerait pour les auteurs de s’interroger plus profondément sur la pertinence et la légitimité, en termes de valeurs, de tous les droits autochtones à dialoguer avec l’Etat. On comprend ce qui n’était pas dit dans l’introduction, à savoir qu’il s’agit de présenter presque toujours ces droits sous leur meilleur jour pour établir, d’abord une sorte de légitimité à entrer en dialogue avec le droit étatique. Plus, une sorte de supériorité des valeurs que ces droits portent, comparées au droit étatique, est régulièrement insinuée. C’est ainsi que les auteurs tendent régulièrement à exprimer une sorte d’inconciliabilité entre les droits autochtones et les droits étatiques, par le heurt, par exemple, entre plusieurs types de conceptions de la propriété. En poussant le raisonnement, on est du même coup conduit à se poser tant la question de la capacité que celle de la légitimité du droit étatique lui-même à entrer en dialogue avec les droits autochtones. Ce propos est saillant lorsque, par exemple, il s’agit d’établir l’absence de vertu des droits étatiques, qui « reposent primordialement sur une conception anthropocentrique et utilitariste de la terre et des ressources naturelles, de même que sur des valeurs, des principes et des règles qui, puisant au libéralisme, au néolibéralisme et au capitalisme, favorise l’appropriation privée des terres et des ressources dans l’optique de stimuler la croissance et l’efficacité sur le plan économique aux fins de satisfaire les besoins immédiats des êtres humains et l’accumulation de profits. Aussi, dans les ordres juridiques étatiques, les processus décisionnels en matière foncière, hautement formalisés, sont généralement centralisés au sein d’organes étatiques spécialisés ». Si le dialogue est présenté comme nécessaire, et l’Etat en position d’acteur dominant, le propos ne paraît donc plus tant celui de l’établissement d’un dialogue constructif, mais la remise en cause pure et simple des valeurs du droit étatique par l’instrument des valeurs des droits autochtones. S’est ainsi opéré un glissement assez net entre l’intention affichée initialement et la réalité de la démarche menée. Le propos est dans tous les cas politique – ce qui est le cas de tout discours sur le droit – mais l’étendue du contenu politique du propos, s’il est bien intériorisé par les auteurs, n’est pas entièrement explicité.
Ce glissement pose enfin la question, dans le cadre d’une recherche sur Comment l’histoire se raconte ?, du choix des objets positifs de la recherche, à savoir la famille, le territoire et le traitement des conflits. La compréhension du choix de ces objets n’est pas aidée par les auteurs parce qu’ils n’en donnent pas vraiment d’explication. On ne peut alors que spéculer, ce qui comprend deux types de risque, mais aussi un avantage : il peut s’agir d’abord de plaquer sa propre compréhension de la chose – celle du lecteur donc – sur la démarche des auteurs. Il est ensuite possible, plus simplement, d’imaginer méticuleusement, à partir de l’ensemble des développements, quelles sont les raisons profondes de ces choix mais sans jamais en avoir de certitude. Dans le cadre de cette démarche aux résultats nécessairement hasardeux, se profile néanmoins l’avantage de pouvoir s’interroger sur les raisons de l’absence d’explication. Il y a toujours un enjeu dans les définitions si bien que, souvent, on préfère s’en passer, et cela laisse place, peut-être assez utilement en fait, à l’imagination
Ainsi, je suppose dans le cas présent, grâce à ce je pourrais appeler une « compréhension cultivée », c’est-à-dire une connaissance générale de la littérature sur le sujet, que les objets positifs choisis par les auteurs pour mener à bien leur démarche auraient été choisis parce qu’ils constitueraient en quelque sorte « le noyau dur » du droit, en tant que la combinaison des valeurs principes, règles, acteurs et processus formerait droit si, a minima, elle est relative à la conception et la constitution anthropologique de la famille, du territoire et du règlement des conflits. Il s’agirait ainsi de catégories universelles du droit qui permettraient de le reconnaître partout, et à partir desquelles on peut décrire les caractéristiques singulières de chaque système[1].
3. Quelles sont les conséquences, dans le paysage juridique et politique, de l’histoire racontée dans Contributions à l’étude des systèmes juridiques autochtones et coutumiers ?
Ces conséquences peuvent être aperçues par les auteurs, être explicitement affirmées dans ce sens ou simplement implicites. Elles peuvent aussi parfois rester inaperçues ou minorées. On peut estimer que les conséquences de la démarche entreprise par les auteurs dans cet ouvrage, qui reste le premier avant un autre ouvrage à venir, relèvent des deux catégories.
En premier lieu, les auteurs soutiennent une thèse « forte » : le droit étatique, par les traits « à charge » régulièrement mis en avant, est considéré comme impropre à la démocratie ou, en tous les cas, non structuré démocratiquement. Et ainsi, dès lors que l’on peut constater la survivance ou le développement d’autres traces de juridicité qui s’en distinguent par les valeurs et principes, c’est la faillite de l’Etat qui est avancée. On comprend ce que cette thèse peut avoir de sulfureux, et peut-être pas toujours voulu par les auteurs, à dire que le droit étatique ne peut pas être considéré comme démocratique dès lors qu’il n’est pas reconnu par tous. Si la non reconnaissance est décelée à travers des comportements qui traduisent d’autres valeurs et d’autres principes, cela donne un pouvoir de contestation automatique aux acteurs non étatiques. La question se pose alors de savoir quels types d’acteurs peuvent bénéficier ou bénéficient vraiment de ce pouvoir de contestation. Il apparaît historiquement que les premiers bénéficiaires des thèses du pluralisme juridique portées depuis les années 1970, mais encore plus depuis les années 1980 et 1990, ne sont pas ceux visés et encouragés par les auteurs, à savoir les sujets des droits autochtones et les peuples autochtones, mais les acteurs de ce qu’on pourrait plutôt appeler des ordres normatifs concurrents, des « fragments constitutionnels » selon la thèse de Gunther Teubner, c’est-à-dire en premier lieu des entreprises multinationales et des Institutions Financières Internationales. L’affaiblissement de l’autorité légitime de l’Etat, soutenu par les différentes thèses du pluralisme juridique, a déjà permis l’élaboration de la loi, tant économique que politique, par des autorités non étatiques. Il n’est pas exemple qu’à regarder comment la théorie de l’Etat de droit a été utilisée par les Institutions Financières Internationales pour imposer aux Etats emprunteurs l’adoption de certains dispositifs juridiques.
Donner à voir une grille de lecture qui ne tient pas compte de cette réalité déjà à l’œuvre a peut-être comme effet secondaire de perpétuer le phénomène sans permettre qu’un autre – celui des droits autochtones – ne puisse trouver une place ainsi revendiquée.
Un dernier point enfin mérite qu’on s’y arrête, qui est même peut-être l’un des plus importants, car il engage l’appréhension du droit de l’Etat, son apprentissage et sa perpétuation dans presque tous les systèmes occidentaux, et maintenant non occidentaux. La posture des auteurs est intéressante, qui consiste à revendiquer une manière de regarder les choses pour reconnaître l’existence d’un droit autochtone et pour l’analyser : la chose est connue en anthropologie du droit puisque, comme l’a notamment relevé Norbert Rouland, le droit n’est pas seulement repérable à partir des discours normatifs, mais aussi à partir des représentations et des pratiques. Trois points d’entrée donc du droit qui permettent d’en saisir mieux la réalité. C’est à cet endroit qu’un « deux poids deux mesures » est repérable dans l’analyse des auteurs, bien qu’ils tendent à s’en défendre à certains endroits : là où les pratiques (mêmes seulement mémorielles ou militantes) sont le cœur du travail de reconnaissance des droits autochtones, il semble que, pour l’essentiel (mais sans que cela soit absolu et général), ils s’en tiennent à la question des énoncés normatifs s’agissant du droit étatique. Or, je crois très fondamentalement que le regard dont usent les auteurs pour identifier et analyser les droits autochtones devrait être aussi celui utilisé pour identifier et analyser le droit de l’Etat. Le droit, quel qu’il soit, d’où qu’il soit est identifiable et analysable à la croisée des discours éventuellement prescriptifs, des représentations et des pratiques : la spécificité du droit occidental de l’Etat est certes d’user d’un arsenal d’énoncés prescriptifs et de charger un ensemble d’institutions spécialisées de leur application, mais ce n’est pas le tout de ce droit. Cela doit être compris surtout comme révélant une manière d’édicter le droit, mais pas nécessairement comme les contenants des valeurs et principe effectivement à l’œuvre dans ce système.
Bref, si un regard plus anthropologique déterminait l’analyse du droit étatique lui-même, cela pourrait peut-être mieux permettre le dialogue souhaité par les auteurs. Au lieu de cela, et pour continuer une tradition, il existe une science juridique qui regarde le droit de l’Etat d’une certaine manière, et une anthropologie qui regarde des système normatifs alternatifs d’une autre manière et se constitue ainsi comme discipline marginale au sein du monde académique. Si l’approche du droit de l’Etat changeait pour intégrer les données de l’anthropologie, il y a fort à parier que l’ensemble des manuels d’introduction au droit changerait d’allure, et diraient autre chose que ce qu’ils disent du droit aujourd’hui. Bien souvent, les anthropologues du droit, pour envisager le droit de l’Etat, paraissent prisonniers de la manière dont ce même droit dicte sa propre manière de se présenter. Il ne suffit pas de regarder « ailleurs » (les droits autochtones) pour s’en défaire ; on peut regarder autrement le droit de l’Etat.
Lauréline Fontaine, novembre 2018- janvier 2019
[1] A cette remarque les auteurs ont répondu qu’aucune logique initiale et théorique n’avait présidé à leur démarche, parce qu’ils avaient été entièrement dépendants du choix opérés par les auteurs des études de terrain. La question est ainsi déportée, mais se pose du coup la question d’en parler ou non : un « aveu » de cette configuration n’aurait pas nuit à la démarche d’ensemble des auteurs, qui ainsi aurait été plus « claire » pour le lecteur scientifique. En tout état de cause, le résultat supposément fortuit est intéressant, qui conduit effectivement à s’interroger sur l’ensemble normatif qui ferait « droit » parce qu’il traite, a minima, ces trois questions du territoire, de la famille et du règlement des conflits.



