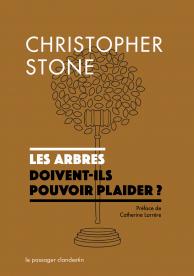Un droit au service de la nature
Impressions sur
Les usages du droit dans les questions environnementales. Réflexions d’une philosophe, Catherine Larrère, Philosophe, Professeure Emérite à l’Université Panthéon-Sorbonne
–
2ème séance de la nouvelle année du séminaire « Les usages du droit dans les recherches académiques en sciences humaines et sociales », le 4 décembre 2017 (thématique et programme du séminaire ici)
Les rapports du droit et de la nature sont depuis longtemps questionnés. Dans la seconde moitié du XXè siècle, c’est plus spécifiquement le rapport à la nature physique, à ses processus, ses caractéristiques, ses fondamentaux, bref, à ce qu’on appelle couramment l’environnement, qui est particulièrement interrogé.
La nature est depuis longtemps un objet de réflexion pour la philosophe Catherine Larrère, qui écrivit sa thèse sur les physiocrates, dont on sait le rapport particulier à la nature qui, pour paradoxal que cela puisse paraître à première vue, les fit être des précurseurs de la science économique moderne. Interroger le rapport de l’homme à la nature dans le monde contemporain ne peut évidemment faire l’impasse sur la question du droit. Mais il y a plusieurs manières alors de se situer par rapport au droit et de situer le droit par rapport à la question. Catherine Larrère s’est intéressée à un texte encore méconnu d’un professeur de droit américain, Christopher Stone, qui fit grand bruit à l’époque de sa publication en 1972, « Les arbres peuvent-ils plaider ? » (« Should tree have standing ? »), dont elle a signé la préface de son édition récente en français. C’est ce texte qu’elle est venue discuter et resituer dans le contexte intellectuel français sur le droit, la nature et l’environnement, lors de la séance du séminaire sur Les usages du droit du 4 décembre.
Les propos de Catherine Larrère furent intéressants à un double titre, puisqu’ils s’arrêtaient sur les propos d’un juriste sur le rapport entre le droit et la nature, et constituaient eux-mêmes le point de vue d’une philosophe sur ce rapport. Dans ce cas, le choix de Catherine Larrère semble plutôt correspondre à un choix d’adhésion, et la différence de point de vue qui pouvait exister est à peine perceptible : clairement, le droit ne semble pas lui-même pris dans une interrogation fondamentale et philosophique quant à son rapport à la nature, puisque c’est l’homme qui est pris dans cette interrogation, le droit étant alors simplement considéré comme un outil, un instrument, que l’homme peut adapter à l’état de ses réflexions, et, surtout, des objectifs qu’il poursuit. Mais, d’un autre côté, il semble être souvent « surclassé », lorsque par exemple il est fait état des progrès considérables accomplis par l’adoption d’une règle juridique nouvelle, dont on sait pourtant que les effets sont mineurs, ou carrément défaits par d’autres mécanismes existants (économiques par exemple). Bien sûr il faut écouter les propos de Catherine Larrère qui n’est jamais aussi explicite sur cette question, mais desquels on peut s’essayer à dégager une conception traversante et implicite du droit. Il demeure que le résultat des évolutions proposées et des analyses menées semble bien être une instrumentalisation du droit et la croyance dans les vertus de ses dispositifs, indépendamment de leur pensée dans un système social et économique plus vaste. On le sait, mais on n’en tient pas compte dirait-on. Les effets de la disciplinarisation et de la scientifisation des recherches semblent être assez forts, et pour le coup dépasser chaque discipline : étudier le droit en soi finit par faire croire qu’il peut être pensé, dans sa conception, ses moyens et ses effets, en soi. Or rien n’est plus erroné, si on considère qu’il est indésolidarisable des conceptions et dispositifs qui permettent à l’homme d’agir dans et sur le monde. Et surtout, qu’une règle qui est à contre-courant d’un mouvement humain général a le plus souvent et au mieux un effet d’alibi, faute de pouvoir être arrimé anthropologiquement.
L.F. janvier 2018
Retrouver les images de l’intervention de Catherine Larrère ici.